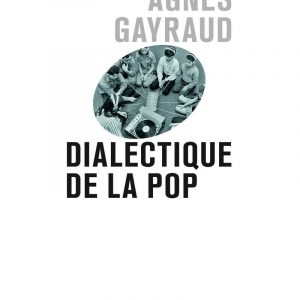
(Cet article est initialement paru sur Le Cargo. Pour ceux que le sujet intéresserait, l’ensemble de mes chroniques pour le webzine est accessible ici.)
De cet ouvrage théorique d’Agnès Gayraud (évoquée jusqu’ici dans nos pages pour son travail sous le nom de La Féline), nous ferons ici une chronique plus superficielle et sans doute un peu moins rigoureuse qu’il ne le mériterait. Ce qui, en creux, reflètera surtout notre expérience personnelle de lecture – ou de première lecture, devrait-on dire, car il semble aller de soi, au moment de refermer ce livre, que nous sommes loin d’en avoir terminé avec lui. Ce n’est pas le genre d’ouvrage dont on se débarrasse sitôt achevé, mais l’un de ceux que l’on garde en bonne place sur son étagère pour revenir y piocher plus tard.
Réflexion et candeur
Au commencement, Dialectique de la pop intimide. Une chronique radio exprimait récemment (tout en saluant l’ouvrage comme « une somme » incontestable) la possibilité de passer à côté de certains aspects si l’on ne possède pas les clés nécessaires, sur un plan musical (ce qui ne fut pas notre cas) ou sur le plan du raisonnement théorique – qui nous a effectivement donné un peu plus de mal, principalement par manque de familiarité avec ce type d’ouvrage. Cela étant, il existe autant de façons d’aborder ce livre qu’il y a de lecteurs. Plutôt que de suivre rigoureusement le cheminement théorique qui le structure, nous avons préféré nous laisser porter par la lecture, picorer tel passage, telle idée, telle anecdote au gré des envies, quitte à revenir creuser le sujet plus tard.
On ne prétendra pas avoir appréhendé chaque ligne de chaque page d’un ouvrage aussi dense et volumineux, mais cette densité même force le respect – on n’ose imaginer la quantité de travail qu’il a dû nécessiter. C’est aussi qu’on sent ce livre nourri de l’expérience et du savoir amassés au fil des ans par quelqu’un que le sujet passionne depuis toujours. Tour à tour philosophe, musicienne et chroniqueuse musicale pour Libération, Agnès Gayraud s’applique depuis longtemps à démonter une idée reçue qui voudrait opposer l’étude théorique d’une forme d’art ou de divertissement et le plaisir plus viscéral qu’elle nous procure. On peut tout à fait, disait-elle déjà à travers les albums de La Féline, réfléchir sur la pop tout en la pratiquant avec une candeur et une passion intactes. Idée qui traverse ce livre comme un fil conducteur : on se trouve ici face à un ouvrage érudit où un amour profond et contagieux pour la musique suinte à chaque ligne.
Un art de paradoxes
Dialectique de la pop se présente comme une réponse aux théories de Theodor W. Adorno, philosophe et musicologue allemand du XXème siècle auquel Agnès Gayraud consacra sa thèse et qu’elle évoque ici sous l’amusant surnom de « hater hyperbolique », convaincu qu’il était de la médiocrité intrinsèque du format pop. À l’austérité de la vision d’Adorno, elle en oppose une autre faite de rigueur mais aussi de bienveillance et de générosité. Une vision dépourvue de tout élitisme, qui brasse un spectre musical très large : du flamenco à la musique cajun, de Rihanna à La Nòvia, de Joni Mitchell à Method Man, de Van Halen à Kurt Weill. Les artistes ne sont pas cités ici en fonction de leur importance objective dans l’histoire de la musique, mais de ce qu’ils illustrent de la réflexion en cours. L’ouvrage brosse un portrait de la pop en l’abordant à travers des questions esthétiques, historiques ou plus techniques : ici la façon dont l’enregistrement (et non pas l’écriture elle-même) fixe une œuvre pop comme version canonique ; là le difficile équilibre entre quête de sincérité et soif de succès ; ailleurs le paradoxe illustré par la chanteuse de country Loretta Lynn dont les chansons se nourrissent de son histoire de fille de mineur alors même que le succès l’en éloigne (ou le « paradoxe du hillbilly » auquel se heurtent certaines œuvres folk et qui donne son titre à l’une des parties les plus intéressantes du livre). Les questions de l’authenticité, de la part de naïveté ou de cynisme, du rapport au progrès et à l’histoire même du format, sont quelques-unes des nombreuses facettes évoquées ici.
L’expérience de lecture de chacun dépendra évidemment de son propre lien avec les musiques évoquées ; ainsi votre matelote aura-t-elle particulièrement apprécié les références à ABBA qui reflètent son propre rapport ambivalent à leurs chansons. Chez un groupe longtemps considéré comme ringard puis remis plus tard au goût du jour, comment dissocier la part de nostalgie embarrassante liée à nos souvenirs d’enfance, et la part d’appréciation plus objective de leurs morceaux ? Quelques-uns, nous dit Agnès Gayraud, survivent au regard critique de l’adulte en conciliant les deux (et de citer « The Winner Takes It All » sur laquelle nous la rejoignons).
Désir de transmission
Mais trêve de digression. Ce que nous retiendrons de cet ouvrage peut-être encore plus que le reste, c’est cet enthousiasme qui nourrit constamment la réflexion. Une approche aussi éloignée de celle d’Adorno qu’on puisse imaginer : ici, jamais de haine ni de mépris, mais un amour profond pour la musique et un désir sincère de transmission. On quitte ce livre avec l’envie furieuse d’aller découvrir quantité de morceaux que nous ne connaissions pas (de Beyoncé à Teenage Fanclub), puis de relire les passages qui leur sont consacrés. C’est un livre vers lequel on reviendra, sans aucun doute. Pour y piocher des anecdotes, pour mieux y cerner la réflexion globale qui nous a un peu échappé en première lecture. Et pour se laisser gagner par ce plaisir, cet appétit de musique, qui imprègnent chaque phrase et ravivent un peu le nôtre.

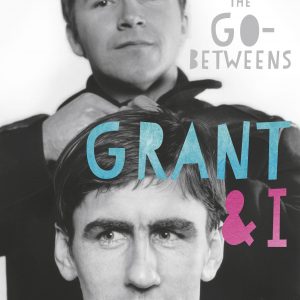 (Cet
(Cet